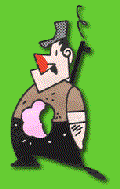-
Septembre 2007. Après un printemps et un été pourris, voilà déjà des senteurs d’automne. Il s’agit certes d’une arrière-saison ensoleillée avec des parfums d’été indien. Les chants des passereaux déboussolés croyant à un regain de printemps masquent à peine de nouveaux bruissements qui rôdent dans les plaines et les bois...
Je scrute vainement les berges d’un ruisseau affluent de la jolie rivière qui coule dans ma vallée : plus aucune trace des adorables rats musqués que je viens observer depuis quelques années. Les plages de sable et de gravier où les petits venaient s’ébattre au soleil sont envahies par la végétation aquatique. Le cresson sauvage que les adultes moissonnaient régulièrement commence à obstruer le lit où s’accumulent déjà toutes sortes de déchets.
Ces gentils lutins sont classés nuisibles, ils détruiraient les berges, et des « protecteurs de la nature » les exterminent à la carabine, comme à la foire... Les bœufs à l’engrais peuvent défoncer les berges impunément, transformer le clair ruisseau en égout boueux. On ne s’oppose pas à la marche du progrès.
Mes chers amis, passionnés d’Arts Martiaux, vous n’ignorez bien sûr pas la signification d’Art Martial ? Art de la Guerre ? Nous devons être bien peu nombreux, dans la toute petite famille de l’Aïkibudo, à avoir effectivement connu la réalité de la guerre en tant que témoins ou acteurs.
Je vais vous proposer la lecture d’un très vieux texte que j’ai découvert il y a près de 60 ans... J’avais 7 ans. Je commençais à me rebeller contre les adultes qui tentaient de me faire croire au père Noël (le bonhomme Coca Cola, obèse et obscène avec son ridicule costume rouge, était en train de réussir son OPA sur le vieux Saint Nicolas qui ne ressusciterait plus les petits enfants partis glaner aux champs et mis au saloir par un méchant boucher), aux cloches de Pâques et autres impostures.
Cette année-là, mon vieil instituteur me donna à lire un texte extrait des Contes du Lundi, d’Alphonse Daudet : Les émotions d’un perdreau rouge. C’est une sorte de fable, écrite après la guerre de 1870, qui fut le prélude à la grande boucherie de 14/18, mère de toutes les abominations qui n’ont cessé depuis. Elle raconte les horreurs de la guerre à travers le miroir des horreurs de la chasse. Et elle contient aussi tous les ingrédients qui font une belle histoire traditionnelle des Arts Martiaux : le vieux sage qui utilise avec sobriété et efficacité les principes fondamentaux de son Art et donne de brillantes démonstrations de stratégie, le jeune disciple attentif et admiratif et tous les autres qui s’agitent et périssent dans des gesticulations dérisoires...
Ce conte me marqua profondément et fut probablement décisif dans le choix de mon cheminement, en toute modestie, philosophique et spirituel. Dès lors, je refusai d’apprendre tout catéchisme, de croire tout mystère révélé, tout prophète autodéclaré (Et ils le sont tous ! Comment vérifier qu’un dieu ou un archange leur a dicté commandements ou versets ou leur a ordonné de massacrer leur progéniture pour prouver leur foi et leur amour…?), d’adhérer à quelque chapelle que ce soit. Tout dogme, quel qu’il soit m’était devenu grotesque.
Beaucoup plus tard, en 1962, en pleine bataille d’Alger, j’ai passé un temps interminable à plat ventre dans un caniveau, nez à nez avec un chien terrorisé qui gémissait pendant que les balles de fusils mitrailleurs sifflaient à quelques centimètres au-dessus de nos têtes et de nos fesses ! J’ai bien cru ne pas pouvoir me retenir de pisser dans mon pantalon tant j’étais effrayé. J’ai repensé à Rouget, le jeune perdreau qui découvre la cruauté humaine et la folie guerrière.
Et aujourd’hui, quand j’entends dans la forêt, au-dessus de chez moi, les vociférations des rabatteurs, les pétarades des fusils et les hurlements des matamores qui tirent sur tout ce qui bouge, je me prends à souhaiter à ces « braves gens » que, comme moi, à leur tour, ils entendent les balles siffler à leurs oreilles et ne puissent se retenir de se pisser dessus !
Aussi loin que remontent mes souvenirs, comme beaucoup de mes contemporains, j’ai été préoccupé par ces grands mystères : d’où vient la vie, quelle est notre place dans l’univers, quelle est notre place dans l’évolution ? Je ne suis pas mystique. Je suis athée et je cherche ce qui peut bien être au-dessus de notre simple humanité. J’adhère volontiers à la pensée de Sri Aurobindo qui pensait que la prochaine évolution de l’être humain toucherait le domaine de la conscience.
Je pourrais être influencé par les grands mouvements spiritualistes orientaux : taoïsme, confucianisme, zen mais je me sens plus près du hozro des Navajos. Hozro signifie marcher dans la beauté, se mettre en harmonie avec l’environnement. Quand les événements climatiques mettent leur existence en péril, quand la sécheresse les menace de famine, alors qu’ici on va prier pour faire tomber la pluie ou que là on va se déchaîner en bourse pour tirer quelques profits supplémentaires du malheur des autres, les Navajos font une cérémonie, une Voie de l’Harmonie, qui va rétablir l’équilibre de leurs relations avec le nouvel environnement... sur la piste marquée de pollen fasse que je marche
sur la piste marquée de pollen fasse que je marche
avec des sauterelles à mes pieds fasse que je marche
avec la rosée à mes pieds fasse que je marche
avec la beauté fasse que je marche
la beauté devant moi fasse que je marche
la beauté derrière moi fasse que je marche
la beauté au-dessous de moi fasse que je marche
la beauté au-dessus de moi fasse que je marche
la beauté tout autour de moi fasse que je marche
dans le vieil âge errant sur la piste de la beauté
avec un sentiment de vie fasse que je marche
dans le vieil âge errant sur la piste de la beauté
à nouveau vivant fasse que je marche
accompli dans la beauté
accompli dans la beauté(Extrait du Kledzé Hatal ou "Nuit des Chants" des indiens Navajos traduction de Jacques Roubaud et Florence Delay)

Ce concept imprègne aussi notre pratique de l’Aïkibudo : recherche de l’harmonie avec notre cadre de vie, esthétique de nos relations humaines et de notre comportement. Désintéressement de notre pratique : Seul celui qui n'espère rien est sans crainte. C'est ce qui le rend difficile à vaincre, et impossible à asservir. On peut le priver de sa victoire, point de son combat. (André Comte-Sponville - L’esprit de l’athéisme)
Notre combat est le seul qui vaille la peine : le combat pour libérer l’être humain, pour lui permettre d’accéder à un nouveau niveau de conscience, plus élevé, qui le dégagera de la barbarie et des croyances infantilisantes et meurtrières.
N.B. Je ne suis pas végétarien ni adepte de la macrobiotique. Je suis né carnivore, l’odeur de la viande qui grille me fait saliver et, malgré ma myopie, j’ai un regard de prédateur. Si, à ma vue, les lointains se limitent à un patchwork de brumes colorées, j’y perçois tout mouvement, toute modification de l’ordonnancement des choses, du minuscule troglodyte qui s’agite dans sa broussaille au cerf qui se risque en lisière... Je ne fais pas de sensiblerie envers les charmantes petites bêtes, je me régale d’un râble de lapin à la moutarde bien doré au four mais j’aime la vie, je respecte la vie et je ne supporte pas qu’on inflige des souffrances à qui que ce soit.
LES ÉMOTIONS D'UN PERDREAU ROUGE
 Vous savez que les perdreaux vont par bandes, se nichent ensemble aux creux des sillons pour s'enlever à la moindre alerte, éparpillés dans la volée comme une poignée de grains qu'on sème. Notre compagnie à nous est gaie et nombreuse, établie en plaine sur la lisière d'un grand bois, ayant du butin et de beaux abris de deux côtés. Aussi, depuis que je savais courir bien emplumé, bien nourri, je me trouvais très heureux de vivre. Pourtant quelque chose m'inquiétait un peu, c'était cette fameuse ouverture de la chasse dont nos mères commençaient à parler tout bas entre elles. Un ancien de notre compagnie me disait toujours à ce propos :« N'aie pas peur, Rouget - on m'appelle Rouget à cause de mon bec et de mes pattes couleur de sorbe - n'aie pas peur, Rouget. Je te prendrai avec moi le jour de l'ouverture et je suis sûr qu'il ne t'arrivera rien. »C'est un vieux coq très malin et encore alerte, quoiqu'il ait le fer à cheval déjà marqué sur la poitrine et quelques plumes blanches par-ci par-là. Tout jeune, il a reçu un grain de plomb dans l'aile, et comme cela l'a rendu un peu lourd, il y regarde à deux fois avant de s'envoler, prend son temps, et se tire d'affaire. Souvent il m'emmenait avec lui jusqu'à l'entrée du bois. Il y a là une singulière petite maison, nichée dans les châtaigniers, muette comme un terrier vide, et toujours fermée.« Regarde bien cette maison, petit, me disait le vieux; quand tu verras de la fumée monter du toit, le seuil et les volets ouverts, ça ira mal pour nous. »Et moi je me fiais à lui, sachant bien qu'il n'en était pas à sa première ouverture. En effet, l'autre matin, au petit jour, j'entends qu'on rappelait tout bas dans le sillon...« Rouget! Rouget! »C'était mon vieux coq. Il avait des yeux extraordinaires.« Viens vite, me dit-il, et fais comme moi. »Je le suivis, à moitié endormi, en me coulant entre les mottes de terre, sans voler, sans presque sauter, comme une souris. Nous allions du côté du bois; et je vis, en passant, qu'il y avait de la fumée à la cheminée de la petite maison, du jour aux fenêtres, et devant la porte ouverte des chasseurs tout équipés, entourés de chiens qui sautaient. Comme nous passions, un des chasseurs cria :« Faisons la plaine ce matin, nous ferons le bois après déjeuner. »Alors je compris pourquoi mon vieux compagnon nous emmenait d'abord sous la futaie. Tout de même le cœur me battait, surtout en pensant à nos pauvres amis. Tout à coup, au moment d'atteindre la lisière, les chiens se mirent à galoper de notre côté...« Rase-toi! Rase-toi! » me dit le vieux en se baissant.En même temps, à dix pas de nous, une caille effarée ouvrit ses ailes et son bec tout grands, et s'envola avec un cri de peur. J'entendis un bruit formidable et nous fûmes entourés par une poussière d'une odeur étrange, toute blanche et toute chaude, bien que le soleil fût à peine levé. J'avais si peur que je ne pouvais courir. Heureusement nous entrions dans le bois. Mon camarade se blottit derrière un petit chêne, je vins me mettre près de lui, et nous restâmes là cachés, à regarder entre les feuilles.
Vous savez que les perdreaux vont par bandes, se nichent ensemble aux creux des sillons pour s'enlever à la moindre alerte, éparpillés dans la volée comme une poignée de grains qu'on sème. Notre compagnie à nous est gaie et nombreuse, établie en plaine sur la lisière d'un grand bois, ayant du butin et de beaux abris de deux côtés. Aussi, depuis que je savais courir bien emplumé, bien nourri, je me trouvais très heureux de vivre. Pourtant quelque chose m'inquiétait un peu, c'était cette fameuse ouverture de la chasse dont nos mères commençaient à parler tout bas entre elles. Un ancien de notre compagnie me disait toujours à ce propos :« N'aie pas peur, Rouget - on m'appelle Rouget à cause de mon bec et de mes pattes couleur de sorbe - n'aie pas peur, Rouget. Je te prendrai avec moi le jour de l'ouverture et je suis sûr qu'il ne t'arrivera rien. »C'est un vieux coq très malin et encore alerte, quoiqu'il ait le fer à cheval déjà marqué sur la poitrine et quelques plumes blanches par-ci par-là. Tout jeune, il a reçu un grain de plomb dans l'aile, et comme cela l'a rendu un peu lourd, il y regarde à deux fois avant de s'envoler, prend son temps, et se tire d'affaire. Souvent il m'emmenait avec lui jusqu'à l'entrée du bois. Il y a là une singulière petite maison, nichée dans les châtaigniers, muette comme un terrier vide, et toujours fermée.« Regarde bien cette maison, petit, me disait le vieux; quand tu verras de la fumée monter du toit, le seuil et les volets ouverts, ça ira mal pour nous. »Et moi je me fiais à lui, sachant bien qu'il n'en était pas à sa première ouverture. En effet, l'autre matin, au petit jour, j'entends qu'on rappelait tout bas dans le sillon...« Rouget! Rouget! »C'était mon vieux coq. Il avait des yeux extraordinaires.« Viens vite, me dit-il, et fais comme moi. »Je le suivis, à moitié endormi, en me coulant entre les mottes de terre, sans voler, sans presque sauter, comme une souris. Nous allions du côté du bois; et je vis, en passant, qu'il y avait de la fumée à la cheminée de la petite maison, du jour aux fenêtres, et devant la porte ouverte des chasseurs tout équipés, entourés de chiens qui sautaient. Comme nous passions, un des chasseurs cria :« Faisons la plaine ce matin, nous ferons le bois après déjeuner. »Alors je compris pourquoi mon vieux compagnon nous emmenait d'abord sous la futaie. Tout de même le cœur me battait, surtout en pensant à nos pauvres amis. Tout à coup, au moment d'atteindre la lisière, les chiens se mirent à galoper de notre côté...« Rase-toi! Rase-toi! » me dit le vieux en se baissant.En même temps, à dix pas de nous, une caille effarée ouvrit ses ailes et son bec tout grands, et s'envola avec un cri de peur. J'entendis un bruit formidable et nous fûmes entourés par une poussière d'une odeur étrange, toute blanche et toute chaude, bien que le soleil fût à peine levé. J'avais si peur que je ne pouvais courir. Heureusement nous entrions dans le bois. Mon camarade se blottit derrière un petit chêne, je vins me mettre près de lui, et nous restâmes là cachés, à regarder entre les feuilles. Dans les champs, c'était une terrible fusillade. À chaque coup, je fermais les yeux, tout étourdi; puis, quand je me décidais à les ouvrir, je voyais la plaine grande et nue, les chiens courant, furetant dans les brins d'herbe, dans les javelles, tournant sur eux-mêmes comme des fous. Derrière eux, les chasseurs juraient, appelaient; les fusils brillaient au soleil. Un moment, dans un petit nuage de fumée, je crus voir - quoiqu'il n'y eût aucun arbre alentour - voler comme des feuilles éparpillées.Mais mon vieux coq me dit que c'étaient des plumes; et en effet, à cent pas devant nous, un superbe perdreau gris tombait dans le sillon en renversant sa tète sanglante.Quand le soleil fut très chaud, très haut, la fusillade s'arrêta subitement. Les chasseurs revenaient vers la petite maison, où l'on entendait pétiller un grand feu de sarments. Ils causaient entre eux, le fusil sur l'épaule, discutaient les coups, pendant que leurs chiens venaient derrière, harassés, la langue pendante...« Ils vont déjeuner, me dit mon compagnon, faisons comme eux. » Et nous entrâmes dans un champ de sarrasin qui est tout près du bois, un grand champ blanc et noir, en fleur et en graine, sentant l'amande. De beaux faisans au plumage mordoré picotaient là, eux aussi, en baissant leurs crêtes rouges de peur d'être vus. Ah! ils étaient moins fiers que d'habitude. Tout en mangeant, ils nous demandèrent des nouvelles et si l'un des leurs était déjà tombé. Pendant ce temps, le déjeuner des chasseurs, d'abord silencieux, devenait de plus en plus bruyant; nous entendions choquer les verres et partir les bouchons des bouteilles. Le vieux trouva qu'il était temps de rejoindre notre abri.À cette heure, on aurait dit que le bois dormait. La petite mare où les chevreuils vont boire n'était troublée par aucun coup de langue, Pas un museau de lapin dans les serpolets de la garenne. On sentait seulement un frémissement mystérieux, comme si chaque feuille, chaque brin d'herbe abritait une vie menacée. Ces gibiers de forêt ont tant de cachettes, les terriers, les fourrés, les fagots, les broussailles et puis les fossés, ces petits fossés de bois qui gardent l'eau si longtemps après qu'il a plu. J'avoue que j'aurais aimé être au fond d'un de ces trous-là; mais mon compagnon préférait rester à découvert, avoir du large, voir de loin et sentir l'air ouvert devant lui.Bien nous en prit, car les chasseurs arrivaient sous le bois. Oh! Ce premier coup de feu en forêt, ce coup de feu qui trouait les feuilles comme une grêle d'avril et marquait les écorces, jamais je ne l'oublierai. Un lapin détala au travers du chemin en arrachant des touffes d'herbe avec ses griffes tendues. Un écureuil dégringola d'un châtaignier en faisant tomber les châtaignes encore vertes. Il y eut deux ou trois vols lourds de gros faisans et un tumulte dans les branches basses, les feuilles sèches, au vent de ce coup de fusil qui agita, réveilla, effraya tout ce qui vivait dans le bois. Des mulots se coulaient au fond de leurs trous, Un cerf-volant, sorti du creux de l'arbre contre lequel nous étions blottis, roulait ses gros jeux bêtes, fixes de terreur, Et puis des demoiselles bleues, des bourdons, des papillons, pauvres bestioles s'effarant de tout côté... Jusqu'à un petit criquet aux ailes écarlates qui vint se poser tout près de mon bec; mais j'étais trop effrayé moi-même pour profiter de sa peur.Le vieux, lui, était toujours aussi calme. Très attentif aux aboiements et aux coups de feu, quand ils se rapprochaient, il me faisait signe, et nous allions un peu plus loin, hors de la portée des chiens et bien cachés par le feuillage, Une fois pourtant je crus que nous étions perdus, L'allée que nous devions traverser était gardée de chaque bout par un chasseur embusqué. D'un côté un grand gaillard à favoris noirs qui faisait sonner toute une ferraille à chacun de ses mouvements, couteau de chasse, cartouchière, boîte à poudre, sans compter de hautes guêtres bouclées jusqu'aux genoux et qui le grandissaient encore; à l'autre bout, un petit vieux, appuyé contre un arbre, fumait tranquillement sa pipe, en clignant des yeux comme s'il voulait dormir. Celui-là ne me faisait pas peur; mais c'était ce grand là-bas...« Tu n'y entends rien, Rouget», me dit mon camarade en riant.Et sans crainte, les ailes toutes grandes, il s'envola presque dans les jambes du terrible chasseur à favoris. Et le fait est que le pauvre homme était si empêtré dans tout son attirail de chasse, si occupé à s'admirer du haut en bas, que lorsqu'il épaula son fusil nous étions déjà hors de portée. Ah! Si les chasseurs savaient, quand ils se croient seuls à un coin de bois, combien de petits yeux fixes les guettent des buissons, combien de petits becs pointus se retiennent de rire à leur maladresse!...Nous allions, nous allions toujours. N'ayant rien de mieux à faire qu'à suivre mon vieux compagnon, mes ailes battaient au vent des siennes pour se replier immobiles aussitôt qu'il se posait. J'ai encore dans les yeux tous les endroits où nous avons passé : la garenne rose de bruyères, pleine de terriers au pied des arbres jaunes, avec ce grand rideau de chênes où il me semblait voir la mort cachée partout, la petite allée verte où ma mère Perdrix avait promené tant de fois sa nichée au soleil de mai, où nous sautions tout en piquant les fourmis rouges qui nous grimpaient aux pattes, où nous rencontrions des petits faisans farauds, lourds comme des poulets, et qui ne voulaient pas jouer avec nous. Je la vis comme dans un rêve, ma petite allée, au moment où une biche la traversait, haute sur ses pattes menues, les yeux grands ouverts et prête à bondir. Puis la mare où l'on vient en partie par quinze ou trente, tous du même vol, levés de la plaine en une minute, pour boire à l'eau de la source et s'éclabousser de gouttelettes qui roulent sur le lustre des plumes... Il y avait au milieu de cette mare un bouquet d'aulnettes très fourré; c'est dans cet îlot que nous nous réfugiâmes. Il aurait fallu que les chiens eussent un fameux nez pour venir nous chercher là. Nous y étions depuis un moment, lorsqu'un chevreuil arriva, se traînant sur trois pattes et laissant une trace rouge sur les mousses derrière lui. C'était si triste à voir que je cachais ma tête sous les feuilles; mais j'entendais le blessé boire dans la mare en soufflant, brûlé de fièvre...Le jour tombait. Les coups de fusil s'éloignaient, devenaient plus rares. Puis tout s'éteignit... C'était fini. Alors nous revînmes tout doucement vers la plaine, pour avoir des nouvelles de notre compagnie. En passant devant la petite maison du bois, je vis quelque chose d'épouvantable, Au rebord d'un fossé, les lièvres au poil roux, les petits lapins gris à queue blanche, gisaient à côté des uns des autres. C'étaient des petites pattes jointes par la mort, qui avaient l'air de demander grâce, des yeux voilés qui semblaient pleurer; puis des perdrix rouges, des perdreaux gris, qui avaient le fer à cheval comme mon camarade, et des jeunes de cette année qui avaient encore comme moi du duvet sous leurs plumes. Savez-vous rien de plus triste qu'un oiseau mort ? C'est si vivant, des ailes! De les voir repliées et froides, ça fait frémir... Un grand chevreuil superbe et calme paraissait endormi, sa petite langue rose dépassant la bouche comme pour lécher encore. Et les chasseurs étaient là, penchés sur cette tuerie, comptant et tirant vers leurs carniers les pattes sanglantes, les ailes déchirées sans respect pour toutes ces blessures fraîches. Les chiens, attachés pour la route, fronçaient encore leurs babines en arrêt, comme s'ils s'apprêtaient à s'élancer de nouveau dans les taillis, Oh! Pendant que le grand soleil se couchait là-bas et qu'ils s'en allaient tous, harassés, allongeant leurs ombres sur les mottes de terre et les sentiers humides de la rosée du soir, comme je les maudissais, comme je les détestais, hommes et bêtes, toute la bande!... Ni mon compagnon ni moi n'avions le courage de jeter comme à l'ordinaire une petite note d'adieu à ce jour qui finissait. Sur notre route nous rencontrions de malheureuses petites bêtes, abattues par un plomb de hasard et restant là, abandonnées aux fourmis, des mulots, le museau plein de poussière, des pies, des hirondelles foudroyées dans leur vol, couchées sur le dos et tendant leurs petites pattes roides vers la nuit qui descendait vite comme elle fait en automne, claire et mouillée. Mais le plus navrant de tout, c'était d'entendre, à la lisière du bois, au bord du pré, et là-bas dans l'oseraie de la rivière, les appels anxieux, tristes, disséminés, auxquels rien ne répondait.Alphonse Daudet (Les contes du lundi)
Dans les champs, c'était une terrible fusillade. À chaque coup, je fermais les yeux, tout étourdi; puis, quand je me décidais à les ouvrir, je voyais la plaine grande et nue, les chiens courant, furetant dans les brins d'herbe, dans les javelles, tournant sur eux-mêmes comme des fous. Derrière eux, les chasseurs juraient, appelaient; les fusils brillaient au soleil. Un moment, dans un petit nuage de fumée, je crus voir - quoiqu'il n'y eût aucun arbre alentour - voler comme des feuilles éparpillées.Mais mon vieux coq me dit que c'étaient des plumes; et en effet, à cent pas devant nous, un superbe perdreau gris tombait dans le sillon en renversant sa tète sanglante.Quand le soleil fut très chaud, très haut, la fusillade s'arrêta subitement. Les chasseurs revenaient vers la petite maison, où l'on entendait pétiller un grand feu de sarments. Ils causaient entre eux, le fusil sur l'épaule, discutaient les coups, pendant que leurs chiens venaient derrière, harassés, la langue pendante...« Ils vont déjeuner, me dit mon compagnon, faisons comme eux. » Et nous entrâmes dans un champ de sarrasin qui est tout près du bois, un grand champ blanc et noir, en fleur et en graine, sentant l'amande. De beaux faisans au plumage mordoré picotaient là, eux aussi, en baissant leurs crêtes rouges de peur d'être vus. Ah! ils étaient moins fiers que d'habitude. Tout en mangeant, ils nous demandèrent des nouvelles et si l'un des leurs était déjà tombé. Pendant ce temps, le déjeuner des chasseurs, d'abord silencieux, devenait de plus en plus bruyant; nous entendions choquer les verres et partir les bouchons des bouteilles. Le vieux trouva qu'il était temps de rejoindre notre abri.À cette heure, on aurait dit que le bois dormait. La petite mare où les chevreuils vont boire n'était troublée par aucun coup de langue, Pas un museau de lapin dans les serpolets de la garenne. On sentait seulement un frémissement mystérieux, comme si chaque feuille, chaque brin d'herbe abritait une vie menacée. Ces gibiers de forêt ont tant de cachettes, les terriers, les fourrés, les fagots, les broussailles et puis les fossés, ces petits fossés de bois qui gardent l'eau si longtemps après qu'il a plu. J'avoue que j'aurais aimé être au fond d'un de ces trous-là; mais mon compagnon préférait rester à découvert, avoir du large, voir de loin et sentir l'air ouvert devant lui.Bien nous en prit, car les chasseurs arrivaient sous le bois. Oh! Ce premier coup de feu en forêt, ce coup de feu qui trouait les feuilles comme une grêle d'avril et marquait les écorces, jamais je ne l'oublierai. Un lapin détala au travers du chemin en arrachant des touffes d'herbe avec ses griffes tendues. Un écureuil dégringola d'un châtaignier en faisant tomber les châtaignes encore vertes. Il y eut deux ou trois vols lourds de gros faisans et un tumulte dans les branches basses, les feuilles sèches, au vent de ce coup de fusil qui agita, réveilla, effraya tout ce qui vivait dans le bois. Des mulots se coulaient au fond de leurs trous, Un cerf-volant, sorti du creux de l'arbre contre lequel nous étions blottis, roulait ses gros jeux bêtes, fixes de terreur, Et puis des demoiselles bleues, des bourdons, des papillons, pauvres bestioles s'effarant de tout côté... Jusqu'à un petit criquet aux ailes écarlates qui vint se poser tout près de mon bec; mais j'étais trop effrayé moi-même pour profiter de sa peur.Le vieux, lui, était toujours aussi calme. Très attentif aux aboiements et aux coups de feu, quand ils se rapprochaient, il me faisait signe, et nous allions un peu plus loin, hors de la portée des chiens et bien cachés par le feuillage, Une fois pourtant je crus que nous étions perdus, L'allée que nous devions traverser était gardée de chaque bout par un chasseur embusqué. D'un côté un grand gaillard à favoris noirs qui faisait sonner toute une ferraille à chacun de ses mouvements, couteau de chasse, cartouchière, boîte à poudre, sans compter de hautes guêtres bouclées jusqu'aux genoux et qui le grandissaient encore; à l'autre bout, un petit vieux, appuyé contre un arbre, fumait tranquillement sa pipe, en clignant des yeux comme s'il voulait dormir. Celui-là ne me faisait pas peur; mais c'était ce grand là-bas...« Tu n'y entends rien, Rouget», me dit mon camarade en riant.Et sans crainte, les ailes toutes grandes, il s'envola presque dans les jambes du terrible chasseur à favoris. Et le fait est que le pauvre homme était si empêtré dans tout son attirail de chasse, si occupé à s'admirer du haut en bas, que lorsqu'il épaula son fusil nous étions déjà hors de portée. Ah! Si les chasseurs savaient, quand ils se croient seuls à un coin de bois, combien de petits yeux fixes les guettent des buissons, combien de petits becs pointus se retiennent de rire à leur maladresse!...Nous allions, nous allions toujours. N'ayant rien de mieux à faire qu'à suivre mon vieux compagnon, mes ailes battaient au vent des siennes pour se replier immobiles aussitôt qu'il se posait. J'ai encore dans les yeux tous les endroits où nous avons passé : la garenne rose de bruyères, pleine de terriers au pied des arbres jaunes, avec ce grand rideau de chênes où il me semblait voir la mort cachée partout, la petite allée verte où ma mère Perdrix avait promené tant de fois sa nichée au soleil de mai, où nous sautions tout en piquant les fourmis rouges qui nous grimpaient aux pattes, où nous rencontrions des petits faisans farauds, lourds comme des poulets, et qui ne voulaient pas jouer avec nous. Je la vis comme dans un rêve, ma petite allée, au moment où une biche la traversait, haute sur ses pattes menues, les yeux grands ouverts et prête à bondir. Puis la mare où l'on vient en partie par quinze ou trente, tous du même vol, levés de la plaine en une minute, pour boire à l'eau de la source et s'éclabousser de gouttelettes qui roulent sur le lustre des plumes... Il y avait au milieu de cette mare un bouquet d'aulnettes très fourré; c'est dans cet îlot que nous nous réfugiâmes. Il aurait fallu que les chiens eussent un fameux nez pour venir nous chercher là. Nous y étions depuis un moment, lorsqu'un chevreuil arriva, se traînant sur trois pattes et laissant une trace rouge sur les mousses derrière lui. C'était si triste à voir que je cachais ma tête sous les feuilles; mais j'entendais le blessé boire dans la mare en soufflant, brûlé de fièvre...Le jour tombait. Les coups de fusil s'éloignaient, devenaient plus rares. Puis tout s'éteignit... C'était fini. Alors nous revînmes tout doucement vers la plaine, pour avoir des nouvelles de notre compagnie. En passant devant la petite maison du bois, je vis quelque chose d'épouvantable, Au rebord d'un fossé, les lièvres au poil roux, les petits lapins gris à queue blanche, gisaient à côté des uns des autres. C'étaient des petites pattes jointes par la mort, qui avaient l'air de demander grâce, des yeux voilés qui semblaient pleurer; puis des perdrix rouges, des perdreaux gris, qui avaient le fer à cheval comme mon camarade, et des jeunes de cette année qui avaient encore comme moi du duvet sous leurs plumes. Savez-vous rien de plus triste qu'un oiseau mort ? C'est si vivant, des ailes! De les voir repliées et froides, ça fait frémir... Un grand chevreuil superbe et calme paraissait endormi, sa petite langue rose dépassant la bouche comme pour lécher encore. Et les chasseurs étaient là, penchés sur cette tuerie, comptant et tirant vers leurs carniers les pattes sanglantes, les ailes déchirées sans respect pour toutes ces blessures fraîches. Les chiens, attachés pour la route, fronçaient encore leurs babines en arrêt, comme s'ils s'apprêtaient à s'élancer de nouveau dans les taillis, Oh! Pendant que le grand soleil se couchait là-bas et qu'ils s'en allaient tous, harassés, allongeant leurs ombres sur les mottes de terre et les sentiers humides de la rosée du soir, comme je les maudissais, comme je les détestais, hommes et bêtes, toute la bande!... Ni mon compagnon ni moi n'avions le courage de jeter comme à l'ordinaire une petite note d'adieu à ce jour qui finissait. Sur notre route nous rencontrions de malheureuses petites bêtes, abattues par un plomb de hasard et restant là, abandonnées aux fourmis, des mulots, le museau plein de poussière, des pies, des hirondelles foudroyées dans leur vol, couchées sur le dos et tendant leurs petites pattes roides vers la nuit qui descendait vite comme elle fait en automne, claire et mouillée. Mais le plus navrant de tout, c'était d'entendre, à la lisière du bois, au bord du pré, et là-bas dans l'oseraie de la rivière, les appels anxieux, tristes, disséminés, auxquels rien ne répondait.Alphonse Daudet (Les contes du lundi)
photo de Youssef Barouti in LES ARTS MARTIAUX DE LA LÉGENDE À LA RÉALITÉ sur un scénario d’André Tellier / 1990 Suivre le flux RSS des articles
Suivre le flux RSS des articles Suivre le flux RSS des commentaires
Suivre le flux RSS des commentaires